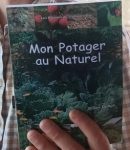Nous nous intéressons aujourd’hui au drainage d’un jardin.
Dans certains jardins, ou parfois simplement à certains endroits du jardin, l’eau ne s’infiltre pas correctement dans le sol.
Elle stagne en surface, formant des flaques d’eau ou rendant la terre très spongieuse.
C’est notamment le cas dans certains jardins avec un sol argileux.
Or, une humidité excessive sera néfaste pour vos cultures :
- Les graines ou les racines peuvent pourrir ;
- Les maladies cryptogamiques sont fréquentes.
Dans ces conditions, drainer le sol sera alors peut-être une solution à envisager.
Mais ne drainez pas une terre légère, qui s’assèche déjà facilement… Vous ne feriez qu’augmenter les besoins en arrosage.
Qu’est-ce que le drainage ?
Le drainage consiste à évacuer ou favoriser l’infiltration de l’eau en excès dans un sol.
En d’autres termes, on va rendre le sol plus perméable à l’eau.
Pour cela, on aura recours à différents procédés, des plus simple aux plus complexes…
Comment drainer un sol de jardin ?
Drainage à la plantation
Cette solution consiste à simplement creuser des trous de plantation beaucoup plus larges et surtout profonds que la motte qui viendra s’y loger :
- Vous placerez, au fond du trou, des pierres (ou galets) sur 30 ou 40 cm d’épaisseur ;
- Vous pouvez également apporter du gravier par-dessus pour améliorer encore le drainage ;
- En terre vraiment lourde, mélangez-y du terreau ou du compost mûr pour l’alléger. Je déconseille le sable comme on le voit souvent… Argiles et sables ne se mélangent pas et vos cultures n’apprécieront pas cette terre mal structurée.
Cette solution est certes relativement simple à mettre en place, mais ne peut s’appliquer qu’aux plantations d’arbres et arbustes. Elle n’est pas adaptée au potager…
Drainer en ouvrant des sillons
Une autre solution consiste à ouvrir des sillons en plusieurs endroits de votre jardin :
- Par exemple avec une bêche, creusez des sillons relativement étroits et profonds (la largeur et la hauteur de la bêche conviennent en général très bien) en différents endroits du jardin, et de préférence, dans le sens de la pente (s’il y en a une) ;
- Remplissez ensuite ce sillon avec du sable de rivière.
L’eau s’infiltrera dans ces sillons et asséchera votre jardin.
Il est évident que plus le terrain est humide, plus nombreux devront être les sillons.
Creuser un fossé
Dans le même ordre d’idées, vous pouvez également creuser un fossé soit simplement dans la partie basse, soit autour de votre jardin.
En cas de fortes pluies, l’eau viendra s’écouler dans ce fossé, assainissant ainsi (temporairement) votre jardin.
Creuser un puits perdu
Il s’agit ici de creuser une fosse profonde de 1 m 50 environ et suffisamment large (carré de 1 m 50).
Placez du géotextile au fond et à remonter sur les bords de la fosse.
Remplissez ensuite ce puits de pierres (ou de vieilles tuiles brisées), puis enfin de graviers et de sable.
L’eau en excès ruissellera dans cette fosse et finira par s’infiltrer en profondeur.
Poser un drain
C’est là la solution la plus durable, mais impliquant des travaux importants.
La pose d’un drain s’effectuera en 3 étapes.
1re étape – Creuser un réseau de tranchées
- Commencez par creuser, au centre du terrain, une tranchée dans le sens de la pente ;
- Creusez ensuite, avec une bêche et une pioche (souvent nécessaire) des tranchées perpendiculaires (tous les 4 ou 5 mètres) rejoignant la tranchée centrale. Et ce en formant une pente (de 1 % minimum) s’inclinant vers la tranchée centrale ; ceci afin de permettre l’écoulement de l’eau.
Comme pour les sillons, la largeur d’une bêche sera parfaitement adaptée. Il faudra par contre creuser plus profondément, en tout cas si vous voulez pouvoir cultiver par-dessus. Ceci afin d’éviter d’atteindre les drains avec vos outils de jardinage. Mais aussi pour que les racines puissent se développer au niveau de la terre.
Sachant que les plantes potagères ont besoin d’une trentaine de cm de terre et que vous devrez recouvrir la gaine (5 à 7 cm pour elle-même) de 20 cm de graviers minimum, il faut donc prévoir une profondeur minimale de tranchée de l’ordre de 60 cm.
Les arbres ne pourront pas être plantés sur des drains. Ils devront être largement décalés (les racines s’étalent aussi en largeur…) par rapport à ceux-ci.
2e étape – Poser le drain
- Afin d’éviter que les drains ne se bouchent par la suite, mettez tout d’abord un feutre de jardin, plutôt épais, et imputrescible, au fond des tranchées et remontant de chaque côté jusqu’au niveau du sol ;
- Déposez ensuite une gaine spéciale drainage (ce sont des gaines perforées, annelées ) en PVC (les tuyaux flexibles sont également possibles, mais beaucoup plus difficiles à maintenir en place), de 50 à 70 mm de diamètre (plus le sol est humide, plus une gaine large sera efficace pour permettre un écoulement rapide de l’eau). Assurez-vous que la gaine suive bien une pente vers l’évacuation (vers le bas du terrain, un fossé ou mieux encore une mare pour le drain central, et vers le drain central pour les drains perpendiculaires).
3e étape – Combler les tranchées
 Recouvrez les gaines de graviers (diamètre 30 – 50 mm), sur au moins 20 cm d’épaisseur ;
Recouvrez les gaines de graviers (diamètre 30 – 50 mm), sur au moins 20 cm d’épaisseur ;- Repliez les côtés du feutre par-dessus les graviers ;
- Comblez les tranchées avec de la terre de jardin.
Une autre approche du “drainage”
(mise à jour du 19/01/2020)
J’ai présenté ci-dessus des techniques de drainage tel que défini dans le dictionnaire Larousse, à savoir (Drainage = Évacuation, spontanée ou facilitée par un réseau de drains ou de fossés, de l’eau en excès dans un sol trop humide.).
J’ai donc omis de parler de techniques culturales permettant elles aussi, finalement, de favoriser l’évacuation des eaux en excès.
Les débats nés dans les commentaires ci-dessus m’ont amené à remettre en cause ma première approche de la question…
En effet, si l’on prend la deuxième définition suivant dans ce même dictionnaire, on peut lire “Drainage = Ensemble de procédés et opérations mis en œuvre pour favoriser cette évacuation ; aménagement des surfaces en vue d’accélérer l’évacuation des eaux.”
Gilles et Alain ont donc tout à fait raison de nous parler de buttes surélevées !
La technique préconisée par Alain, consistant également à creuser des allées me semble encore plus appropriée.
Voici ce que dit Alain : “Dans ma terre très argileuse, j’ai donc creusé des allées de 40 ou 50 centimètres de large qui servent de drains. Puis, j’ai utilisé de la volige pour surélever mes planches de culture où j’apporte beaucoup de compost en plus du couvert permanent. En quelques années (moins de cinq ans pour être précis) ma terre lourde et collante est devenue comme du terreau. A chaque pluie, les allées sont remplies d’eau qui s’infiltre ensuite lentement dans le sol, sous les planches de culture, le complexe argilo-humique et la porosité du sol, désormais, permet de stocker l’eau pour les besoins des plantes. Mais en surface, mes planches ne sont jamais submergées.”
Dans le même ordre d’idées, nous pourrions aussi parler ici des engrais verts…
Ajoutons à cela que, comme nous en a alertés Manou également dans les commentaires, que le drainage, en tout cas certaines techniques de drainage, ne sont pas sans conséquence d’un point de vue écologique. En effet, en évacuant les eaux en excès, plutôt qu’en les faisant s’infiltrer dans le sol, on contribue à l’assèchement du sol, avec des conséquences pouvant être catastrophiques (Incendies… et inondations des terres vers lesquelles sont évacuées ces eaux).
Bref, dans le premier “jet” de cet article, je pense avoir manqué de recul… Et je remercie Gilles, Alain et Manou de m’avoir interpellé !
Alors, au final, plutôt que de chercher à évacuer ces eaux en excès, n’est-il pas plus judicieux de mettre en place des pratiques culturales adaptées à ce type de sol ? C’est en tout cas ce que je pense…
Et vous-même, qu’en pensez-vous ?
Vos réflexions et contributions sont bienvenues pour continuer le débat, et contribuer ainsi à l’élaboration de pratiques efficaces, mais aussi, et surtout, plus respectueuses de notre environnement, dans les commentaires ci-dessous…


 Recouvrez les gaines de graviers (diamètre 30 – 50 mm), sur au moins 20 cm d’épaisseur ;
Recouvrez les gaines de graviers (diamètre 30 – 50 mm), sur au moins 20 cm d’épaisseur ;