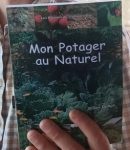Les projets d’installation en maraîchage bio sur petite surface sont de plus en plus nombreux, en particulier en permaculture.
J’ai le plaisir d’accompagner quelques-uns de ces nouveaux installés. Et je ne peux que me réjouir de cet engouement important et assez récent.
Néanmoins, et notamment parce qu’accompagner des projets me permet de pointer du doigt certaines réalités concrètes, il me semble important d’apporter aujourd’hui une pointe de réalisme… Ceci afin d’éviter peut-être bien des désillusions à certains porteurs de projet.
Prenons pour exemple un modèle d’installation en maraîchage sur petite surface particulièrement relayé sur les médias.
Il s’agit de la ferme du Bec-Hellouin :
ETUDE-INRA-MARAICHAGE_100413
Certains (notamment via des sites dont le but premier est de vendre des formations) prétendent, se reposant sur un travail de recherche effectué en collaboration avec quelques chercheurs de l’INRA, que le modèle mis en avant sur cette ferme, est la preuve que l’on peut s’installer sur 1 000 m2 et en espérer un chiffre d’affaires de 50 000 € … De quoi faire rêver plus d’un candidat à l’installation !
Pourtant, si l’on se penche sur le rapport en question, les conclusions ne sont pas tout à fait les mêmes. Loin s’en faut…
viabilite_maraichage_bio_sans_motorisation_fr
On note tout d’abord que les chiffres avancés sont des projections, en aucun cas des chiffres réels : “Les résultats présentés sont donc le fruit d’une modélisation théorique et ne sont pas les résultats économiques de la ferme du Bec-Hellouin qui cultive 4 500 m2 de légumes sur une superficie totale de 20 ha”
On n’y lit également tout à fait clairement que “cette étude ne dit pas qu’une ferme de 1000 m2 puisse être viable“.
Les choses sont claires… Ceux qui “vendent” ce modèle d’installation manipulent un peu les choses…
Qui plus est, il me semble aussi essentiel de considérer plus en avant les contraintes matérielles.
Maraîchage sur petites surfaces – Des contraintes matérielles
Des matériaux organiques en quantités importantes
Les pratiques mises en œuvre sur la ferme “modèle” requièrent des quantités importantes de matières organiques diverses (fumier, paillages…)
Or, on note dans l’étude que la surface totale de la ferme est de… 20 hectares.
Une surface conséquente (on est en tout cas loin de la micro-ferme).
Cette surface permet à priori de disposer de matières organiques en quantité suffisante aux besoins de la ferme… Bien qu’en réalité, le fumier provienne tout de même de l’extérieur, notons que la provenance reste néanmoins locale).
Mais tout le monde n’a pas l’opportunité de disposer de 20 hectares !
Les terres à cultiver sont difficiles à trouver. Et les nouveaux installés doivent, pour beaucoup, se contenter d’une surface totale de moins d’un hectare (ou même beaucoup moins)… On comprendra alors que les possibilités d’approvisionnement en matériaux issus de la ferme sont nettement restreintes.
Notons également qu’une surface préservée de 20 hectares est certes idéale du point de vue des équilibres. Mais elle correspond donc là encore peu à la réalité des nouveaux installés sur petite surface…
Le modèle de la ferme du Bec ne peut donc servir de référence à un projet d’installation sur petite surface, car ce n’est tout simplement pas sa réalité. Nous parlons en réalité d’une ferme de taille conséquente dont une petite partie seulement est consacrée au maraîchage.
Beaucoup de main-d’œuvre pour du maraîchage sur petite surface
Posons maintenant comme évidence que de travailler à plusieurs sur 4 500 m2 permet une plus grande efficacité qu’une personne seule sur 1000 m2…
Et quand je dis “plusieurs”, il s’agit, dans le cas de la ferme du Bec-Hellouin, de permanents (au nombre de 8, semble-t-il) plus de nombreux stagiaires de passage…
Le travail de mise en place des buttes par exemple est un travail de titan. Évidemment, c’est beaucoup plus facile quand il est effectué par des stagiaires… Constituer des buttes en travaillant seul, c’est une autre histoire, croyez-moi.
Le désherbage représente aussi une charge de travail conséquente ; charge difficile à assumer pour une personne seule.
Voici d’ailleurs ce que l’on peut lire (http://www.lutopik.com/article/bec-hellouin-en-debat) : “le nouveau rapport indique cependant que la charge de travail serait trop importante pour une personne seule, d’autant que les heures ne prennent pas en compte le temps passé à l’entretien général du site et du matériel, la gestion et la commercialisation notamment, et qu’il existe des pics de charge ponctuels. Les opérations de désherbage, par exemple, demandent beaucoup d’heures et doivent être réalisées dans un intervalle de temps court. Si au Bec-Hellouin, elles sont facilement surmontables grâce aux nombreux stagiaires présents sur place, elles seraient sans eux difficilement réalisables.”
Beaucoup de serres
Alors qu’en moyenne, un maraîcher bio consacre environ 10 % de sa surface totale à des cultures sous serre, cette proportion monte à 40 % sur la ferme du Bec-Hellouin.
Le fait de cultiver sous serre permet une meilleure productivité. Mais n’oublions pas de prendre en compte le coût écologique de fabrication du plastique.
On l’a vu, la réalité du modèle présenté (4 500 m2 de cultivés sur une surface totale de 20 hectares) est loin du modèle de micro-ferme vendu par certains…
Et, si le modèle cultural mis en place sur la ferme est plutôt idéal, il présente des contraintes importantes (matériaux, main d’œuvre) finalement peu adaptées à un nouvel installé sur une (vraie) petite surface.
La transposition des chiffres est aisée… La réalité est tout autre.
Vraiment de la permaculture ?
Ce modèle d’installation en maraîchage sur petite surface est par ailleurs présenté par beaucoup comme relevant de la permaculture. Mais qu’en est-il vraiment ?
Les légumes cultivés sur la ferme sont sélectionnés avant tout pour leur rentabilité (pas de pommes de terre ou d’oignons par exemple…). On privilégie donc les légumes-feuilles et les légumes-fruits qui ont généralement une haute valeur ajoutée.
Or, à mon sens, et j’ose espérer que c’est aussi vrai en permaculture, un maraîcher local se doit de fournir ses concitoyens en légumes diversifiés et répondant à leurs besoins ; il joue ainsi un rôle social et n’est pas seulement là pour rentabiliser au mieux chaque m² de culture.
On observe également que les rotations de cultures sont incessantes. Dès lors, on parle bien de sur-exploitation des terres (quitte à devoir sur-fertiliser).
Enfin, partant d’un principe premier de la permaculture, les matières organiques doivent provenir de la ferme. En réalité, sur une petite surface, c’est loin d’être évident à appliquer.
On est donc de toute évidence dans une approche productiviste, visant avant tout à la rentabilité… donc loin de la permaculture… On est en fait plutôt dans ce que j’appelle le maraîchage bio-intensif.
Des points positifs
Mais tout ceci ne doit pas nous faire occulter les points positifs de l’expérimentation mené sur la ferme du Bec-Héllouin :
- Une petite surface permet “un plus haut niveau de soins aux plantes” ;
- L’utilisation de couches chaudes permet un meilleur étalement des cultures, sans consommation d’énergie électrique ;
- La mise en place de planches permanentes protège le sol en le maintenant constamment couvert ;
- À terme, une amélioration sensible de la qualité du sol est probable ;
- Cela participe à la recherche de solutions nouvelles et à la transmission d’expérience(s)…
Conclusion
Mon objectif n’est pas ici de lancer une polémique (elle existe déjà sur le web) et surtout pas de dénigrer le travail fourni sur la ferme du Bec-Helloin. Et nous l’avons vu, l’approche culturale est intéressante à bien des points de vue.
Non, j’ai simplement essayé de recadrer les choses, apporter un éclairage sur une transposition pour le moins hâtive que ce que certains vendent (souvent très cher) comme modèle de maraîchage en permaculture… avec des objectifs de rentabilité impressionnants (mais purement fictifs).
Soyons clairs, cette expérience, aussi intéressante soit-elle n’est pas transposable en “modèle d’installation sur 1 000 m 2 et plus de 50 000 € de C.A”.
Alors, oui, on peut vivre du maraîchage sur petite surface, mais je ne pense pas qu’une surface de 1000 m2 soit suffisante (Comptez plutôt au moins 3 à 5 000 m2 par personne ; le mieux étant, je pense, de travailler à plusieurs sur une surface un peu plus importante.)…
Et surtout, basez votre projet sur votre propre situation (surface totale, matériaux à disposition, disponibilité…) plutôt que sur un modèle tout fait, mais peu réaliste.
À LIRE :
Le jardinier-maraîcher – Manuel d’agriculture biologique sur petite surface de Jean-Martin Fortier
Néo-paysans, le guide (très) pratique: Toutes les étapes de l’installation en agroécologie de Bruno Macias et Sidney Flament