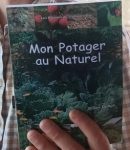Rédigé par des maraîchers parisiens de l’époque, le Manuel pratique de la culture maraîchère de Paris est paru au milieu du XIXe siècle.
Cherchant à concilier culture hyper-productive sur de petites surfaces et respect de l’environnement cet ouvrage reste étonnamment moderne. Il pose en quelque sorte les premiers jalons de ce que l’on appelle aujourd’hui “micro-agriculture bio-intensive“.
Des jardiniers-maraîchers, comme par exemple Jean-Martin Fortin (maraîcher bio canadien auteur de “Le jardinier maraîcher ; manuel d’agriculture biologique sur petite surface“), démontrent aujourd’hui, en s’appuyant sur les techniques traitées dans cet ouvrage, et mettant également à profit certaines connaissances et technologies modernes, qu’il est possible d’obtenir des rendements exceptionnels tout en cultivant de façon écologique.
Mais voyons ensemble les points importants de ce livre.
Petit topo historique sur la culture maraîchère de Paris au XIXe
Le livre commence par un petit historique du maraîchage en région parisienne.
On y découvre avec plaisir les conditions de vie de la classe maraîchère de l’époque. Le déroulement d’une journée de travail, les us et coutumes et mœurs (exemplaires au dire des auteurs) sont ainsi détaillés, pour le plus grand plaisir du lecteur. Passionnant !
La connaissance de son environnement
Loin de l’agriculture intensive moderne, les cultivateurs de l’époque savaient observer leur environnement.
Ils prenaient en compte des données essentielles et tiraient ainsi le meilleur profit de leurs cultures… Tout en respectant leur environnement naturel :
- Le type de sol : les auteurs prônent par exemple, en terre sableuse, l’utilisation de fumier de vache – un matériau gras – alors qu’en terre plus lourde, mieux vaut employer du fumier de cheval – un matériau plus léger – Il est aussi recommandé de pailler moins épais, et plus tard, en terre argileuse (un paillage trop précoce et épais nuisant alors au réchauffement du sol) ;
- L’exposition du terrain : les cultures précoces ainsi que les cultures nécessitant du soleil (tomates, aubergines, melons…) bénéficiaient, si possible, d’une exposition plein sud ; à contrario, les cultures sensibles aux fortes chaleurs (salades en été par exemple) profitaient d’ombrages (cultures hautes, murs, palissades…).
- La situation locale : la proximité ou non d’un marché ou d’un point d’eau, les routes existantes déterminaient d’emblée le fonctionnement de l’activité.
La culture de primeurs
En ce que cela leur permettait de proposer des légumes frais toute l’année, la culture des primeurs constituait un pan très important de l’activité des maraîchers parisiens.
Pour cultiver des légumes primeurs, ils mettaient notamment des châssis. Ces châssis étaient garnis de fumier frais (pour la chauffe) et d’un lit de terreau. Ils utilisaient pour cela les vieilles couches décomposées.
C’est ce même principe que j’utilise aujourd’hui pour le développement précoce de certains plants de légumes (tomates, aubergines et poivrons) en couches chaudes… Et la lecture de ce manuel me donne envie de développer cela pour y effectuer également des semis directs en hiver. Je pense aux salades, mais aussi aux carottes courtes, aux radis, aux navets hâtifs, voire encore aux épinards ou même aux melons. Les maraîchers parisiens en récoltaient ainsi dès le mois d’avril…
Les techniques écologiques de culture mises en œuvre
Les différentes techniques culturales décrites dans ce livre découlent du bon sens. Je retrouve ainsi nombres de pratiques écologiques qui me sont familières. Citons par exemple :
- L’utilisation de couches chaudes pour les cultures précoces, comme nous venons de le voir ;
- L’emploi de matières organiques (en l’occurrence du fumier) pour fertiliser le sol – Avec une différence notable : le compostage ; cette pratique, bien que connue depuis fort longtemps, semble être peu utilisée à l’époque (?) ;
- L’échelonnement des cultures pour une production répartie sur l’année ;
- La diversification des espèces légumières et des variétés au sein d’une même espèce, ce qui permet également d’étaler les productions et assure en même temps une biodiversité plus importante ;
- La pratique du paillage pour limiter l’assèchement du sol ;
- Les rotations de cultures étaient de mise. Ainsi, les cultures peu gourmandes suivaient des cultures plus exigeantes ;
- Les mises en culture intercalaires au milieu d’une autre culture en fin de végétation. Les intérêts en sont multiples : gain de place, couverture du sol, ombrage pour les espèces fragiles en été.
Les différentes cultures maraîchères de Paris au XIXe
Mais cet ouvrage se veut avant tout pratique.
Aussi, on peut y consulter, mois par mois, des conseils utiles pour les principales cultures légumières de l’époque. Ce sont d’ailleurs en gros les mêmes qu’aujourd’hui… Avec en plus quelques légumes oubliés – panais, scorsonère par exemple – remis au goût du jour par les maraîchers bio contemporains).
Les maladies observées à l’époque sont également détaillées. Mais, visiblement, les problèmes rencontrés étaient alors beaucoup moins nombreux qu’aujourd’hui… D’où certaines lacunes (Le point faible de l’ouvrage, et pour cause… Nombre de “ravageurs” ou maladies n’étaient pas encore apparus…). Je suis bien entendu à votre disposition pour vous aider à déterminer les ravageurs ou maladies actuelles et surtout à y remédier.
On y trouve encore un chapitre passionnant sur la reproduction des semences.
Une liste descriptive des outils et un lexique viennent compléter ce livre. Les outils, tout comme les termes techniques employés, sont, pour la plupart, encore d’usage aujourd’hui.
Conclusion
 J’ai littéralement dévoré cet ouvrage !
J’ai littéralement dévoré cet ouvrage !
Le bon sens paysan émanant des pages de ce livre, allié aux connaissances et aux améliorations techniques actuelles, nous donne toutes les clés pour obtenir de belles récoltes potagères.
Bien que destiné au départ aux maraîchers, les jardiniers amateurs y trouveront également quantités d’enseignements pratiques.
Cet ouvrage est aujourd’hui dans le domaine public. Toutefois, les versions (gratuites) que l’on peut trouver sur Internet sont malheureusement difficilement lisibles. C’est pour cette raison qu’Alex Richard a décidé de le retranscrire mot à mot pour en proposer une version au format Kindle (lisible sur PC, Mac, tablettes, iPhone…) beaucoup plus agréable et facile à lire (vous trouverez cette version chez Amazon).
Mais mieux : le Manuel pratique de la culture maraîchère de Paris est aujourd’hui à nouveau disponible en version papier (réimpression en fac-similé de la version d’origine).