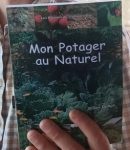En jardinage naturel, et plus particulièrement encore dans le courant de la permaculture (qui, soit dit en passant, n’a rien inventé…), la couverture permanente du sol est une pratique recommandée.
Et en effet, couvrir le sol de son jardin est incontestablement la meilleure approche qui puisse exister. Tout au moins pour ce qui concerne la vie du sol,
Mais encore faut-il ne pas faire n’importe quoi :
- Quel type de couverture mettre en place ?
- Quels sont les avantages d’une couverture permanente du sol ?
- Quels en sont les inconvénients ?
Comment couvrir le sol d’un potager ?
Il existe différentes façons de couvrir le sol, plus ou moins adaptées à un type de sol ou un climat donné.
Essayons d’y voir plus clair.
Paillage et Mulching
On distingue le paillage du mulching.
Bien que tout le monde ne soit pas d’accord sur ces définitions, pour clarifier mon propos, je vais ici vous transmettre celles que j’utilise (comme bien d’autres jardiniers) :
- On paille une culture, c’est-à-dire que l’on va amener des matières végétales au pied de cette culture ;
- On va par contre mulcher un sol. Ce qui signifie que l’on va couvrir le sol, dans un objectif permanent, par des apports répétés de matières organiques diverses, normalement issues de notre environnement.
C’est donc plutôt de mulching dont nous parlons ici.

Je vous invite à lire l’article paru précédemment sur ce blog pour voir les différents matériaux pouvant être utilisés, lesquels sont plus adaptés à tel ou tel type de sol, ainsi que les conditions de mise en place d’une couverture.
Couvrir un sol permet de limiter l’érosion, de l’enrichir, de limiter le développement des adventices ou encore de protéger les cultures et le sol des intempéries… Mais encore faut-il ne pas pailler trop tôt, sous peine de nuire aux cultures…
Démarrez le mulching (ou paillage permanent si vous préférez) de préférence au début de l’automne, lorsque le sol est encore chaud tout en ayant bénéficié de pluies (l’eau est indispensable au développement des différentes formes de vie).
On complétera ensuite, au fil des saisons, cette couverture par des apports réguliers de matières végétales variées (azotées et carbonées). Dès lors, le sol ne sera plus jamais à nu.
Engrais verts
Benoit nous fait l’honneur de consacrer une série d’articles très complets à la culture des engrais verts.
Je vous invite à lire ses articles… Mais pour résumer un peu les choses, disons que les engrais verts, outre le fait qu’ils permettent de couvrir le sol de façon très vivante, présentent de nombreux intérêts :
- Ils décompactent et aèrent les sols lourds ;
- Ils favorisent la vie du sol et l’enrichissent en matières organiques (à condition de les laisser en place) ;
- Ils concurrencent les adventices et permettent donc de semer ou de planter dans un sol “propre” ;
- Si l’on utilise des légumineuses, ils captent l’azote atmosphérique.
On fera donc se succéder cultures d’engrais verts et cultures légumières, assurant ainsi une couverture permanente du sol.
Vous pouvez également cultiver certains engrais verts en intercalaire entre d’autres cultures, ceci afin notamment d’assurer une couverture plus importante. Je pense notamment aux épinards, mais vous pourrez voir à la lecture de ses articles que Benoît, par exemple, en utilise bien d’autres de cette façon…
Le principal inconvénient des engrais verts réside dans l’occupation du sol pendant leurs cultures… Cela peut donc poser problème dans de petits jardins.
Par ailleurs, pour se développer les engrais verts vont puiser dans les réserves du sol. Aussi, personnellement, je les déconseille dans les sols pauvres (notamment les terres sableuses).
La végétation spontanée comme couverture permanente du sol

Parmi les pratiques de couverture du sol, on en oublie en général une, qui est pourtant la plus naturelle… Et donc bien souvent la plus adaptée : laisser la végétation spontanée se développer au pied des plantes cultivées.
Alors, certes, avec des plants encore peu développés, ou s’il s’agit de légumes racines, la concurrence de cette végétation peut poser problème.
Mais lorsqu’un légume à fort développement, ou à plus forte raison un arbre ou arbuste, sera bien développé, laisser les adventices pousser à son pied est à mon sens, et par expérience, une solution tout à fait appropriée et très bénéfique pour la vie du sol…
Buttes vivantes permanentes
La constitution de buttes vivantes est une technique de plus en plus adoptée par les jardiniers.
Je vous invite à lire l’article sur les buttes-lasagnes.

Si cette façon de procéder permet par exemple de pouvoir cultiver sur un sol inculte, ou présentant trop de désavantages, il ne faut pas perdre de vue le travail considérable de mise en place et un besoin très important en matières organiques.
Tout comme avec un mulching, apportez régulièrement de nouvelles matières par-dessus la butte. Vous assurerez ainsi une couverture permanente du support de culture.
Cultures resserrées sur une planche
On peut aussi tout à fait envisager de couvrir le sol de façon plus ou moins permanente en resserrant les cultures sur une planche :
- Soit avec un même légume. Par exemple, on sèmera des carottes sur des lignes espacées de 10-15 cm au lieu des 25 – 30 cm habituellement recommandés ;
- Soit en associant des légumes se développant différemment. Par exemple un légume racine, un légume feuille et un légume fruit, ainsi que des aromates ou des fleurs… Là encore, on écartera moins les lignes de cultures que la normale.

Cette façon de faire est très intéressante non seulement par la couverture du sol qu’elle va rapidement permettre (le temps que les cultures se développent), mais aussi par une meilleure productivité sur une petite surface.
Notez toutefois que les travaux de désherbage, parfois nécessaires en début de culture, sont alors fastidieux. Car de petits écartements permettent difficilement l’utilisation d’un sarcloir, d’une binette ou même d’une serfouette…
Paillage synthétique
On trouve aujourd’hui dans le commerce spécialisé des films de paillage “écologiques” (organiques et biodégradables).
Cela peut être une solution de facilité pour ne pas laisser les sols à nu.
Mais cela représente un coût plutôt conséquent et présente peu d’intérêt pour l’enrichir…
Pourquoi mettre en place une couverture permanente du sol ?
Les intérêts d’une couverture permanente du sol sont nombreux.
Citons les plus importants :
- Limiter l’érosion. On peut observer facilement cet intérêt en cas de pluies diluviennes : en sol nu, la terre est facilement emportée, alors que si elle est couverte, cela ne bouge pas (ou très peu) ;
- Économiser l’eau : avec un paillage, on peut diviser les arrosages par 2 ou par 3 ;
- Protéger et favoriser la vie du sol. Vers de terre et autres micro-organismes vivants sont à l’abri des intempéries et il n’y a plus de travail mécanique (très perturbateur) ;
- Limiter le développement des adventices. Et même si certaines d’entre-elles parviennent à traverser le paillage, vous les arracherez plus facilement ;
- Enrichir le sol en matières organiques par la décomposition progressive de celles qui sont apportées au fil des saisons ;
- Protéger certains légumes du contact direct avec le sol (pouvant engendrer des maladies).
Les inconvénients d’une couverture permanente du sol
Nous l’avons vu plus haut, dans le cas d’un mulching ou de buttes vivantes, les besoins en matières organiques sont importants.
Les ravageurs tels que les limaces ou des petits rongeurs aiment trouver refuge dans un paillage… Cela peut parfois occasionner des dégâts réellement conséquents, et nombre de jardiniers abandonnent cette pratique pour cette raison.
Les engrais verts occupent le sol pendant une durée importante, au détriment de l’espace nécessaire pour les cultures vivrières. Aussi, cette pratique n’est réellement envisageable que si l’on dispose d’une surface suffisante.
Il n’est pas forcément aisé de semer en direct dans une couverture (je pense en particulier aux carottes); cela reste néanmoins possible en écartant le paillage le temps du semis et de la levée.
Vous ramenez la couverture lorsque le plant sera déjà bien développé. Certains procèdent autrement : ils écartent le paillage, épandent directement les graines sur le sol puis recouvrent de terreau (ou de compost parfaitement mûr).
Cette technique est intéressante, mais encore faut-il disposer de suffisamment de terreau fait maison (le coût est trop important à mon sens si l’on doit acheter ce terreau).
Et vous-même, comment couvrez vous le sol de votre potager naturel ? Quels enseignements avez-vous pu en tirer ?