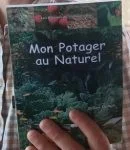Mauvaise herbe ou adventice ?
Quel jardinier n’a jamais pesté contre les mauvaises herbes au potager : “mes cultures sont envahies par cette saloperie… Comment désherber ?” . Pourtant, chaque plante spontanée, chaque herbe, outre l’abri qu’elle constitue pour toute une faune utile, joue un rôle essentiel au jardin.
Jamais elle n’est là par hasard, mais elle répond au contraire à un besoin (un manque, un excès, un déséquilibre, un blocage, un tassement…).
L’objectif de cet article est donc d’apprendre à mieux connaître les adventices (le terme que devrait employer tout jardinier bio) fréquemment rencontrées au potager naturel.
Non pas non pour chercher à tout prix à les éradiquer, mais plutôt pour comprendre les raisons de leur présence et mettre en œuvre les actions en découlant (décompactage du sol, apport ou non de matières organiques, cultures d’engrais verts…) ou simplement l’accepter.
Sachant que lorsqu’elles auront rempli leur rôle, les plantes adventices disparaîtront d’elles-mêmes pour, en général, laisser place à une végétation moins gênante pour les cultures…
Les adventices témoignant d’un sol déséquilibré
Le liseron des champs (Convolvulus arvensis)
Le liseron des champs est une plante vivace rampante (ou grimpante si elle trouve un support) faisant partie des convolvulacées.
C’est sans doute l’une des plantes adventices les plus envahissantes…
Il se reproduit par multiplication des rhizomes et essaimage des graines. Il convient donc d’éviter le passage d’engins rotatifs qui auront pour effet de multiplier les bouts de rhizomes.
Une culture d’engrais verts (mélange seigle/vesce) semés à l’automne, par son action nettoyante, permet de limiter sa propagation.
Mais le liseron, plante adventice par excellence, témoigne avant tout d’un sous-sol tassé, d’une certaine richesse en azote, mais également d’une carence en silice.

En s’implantant le liseron, de par des racines profondes, va justement décompacter le sous-sol et libérer de la silice, remédiant ainsi au manque initial.
Ses fleurs attirent notamment les abeilles et les syrphes (un auxiliaire raffolant des pucerons…).
Riche en azote et divers oligo-éléments, le liseron pourra être utilement apporté, après séchage, au compost.
Pour en savoir plus sur cette plante, je vous invite à consulter l’article que j’ai récemment publié au sujet du liseron.
Le chiendent (Elytrigia repens)
Appartenant à la famille des poacées, le chiendent est une plante adventice, de la famille des graminées, aux longs rhizomes témoignant d’un sol fatigué et dont il est très difficile de se débarrasser.
Tout comme pour le liseron, le passage d’engins rotatifs va multiplier ses rhizomes. Il peut également se reproduire par propagation des graines.
La culture d’engrais verts nettoyants (Sarrazin en culture d’été ou seigle/vesce en culture d’hiver) limitera sa propagation.
On peut également en venir à bout en plaquant au sol une bâche plastique noire pendant plusieurs mois.
Dans les terrains pentus, le chiendent prévient les problèmes d’érosion.
Diurétique, rafraîchissant, émollient, le chiendent est une plante médicinale également comestible.
Il constitue un fourrage de qualité qu’apprécient particulièrement les moutons.
La datura commune (datura stramonium)

Appartenant à la famille des solanacées, la datura officinale (ou commune) est une plante annuelle très commune en Europe et pouvant mesurer jusqu’à 2 mètres de hauteur.
Elle se reproduit naturellement par essaimage des graines.
Le datura (le genre est masculin alors que les espèces sont des mots féminins) apparaît fréquemment dans les sols pauvres en matières organiques, fraîchement retournés.
Ainsi, par des apports réguliers de matières organiques (fumiers, compost, engrais verts…), on éliminera peu à peu cette plante de son potager.
Le datura peut également indiquer un sol pollué. Capable de fixer des métaux lourds (bore, cuivre, cadmium, plutonium) ; sa raison d’être est alors de dépolluer le sol.
La datura est également réputée attirer les doryphores qui vont y pondre leurs œufs. Les larves, en se nourrissant de ses feuilles, vont alors s’empoisonner.
On aura toutefois soin de ne pas laisser le datura monter en graines (maturation de juillet à octobre), sans quoi, l’envahissement risque de se prolonger bien au-delà de la période de “purification”.
Signalons également que la datura est une plante extrêmement toxique (les graines contiennent des alcaloïdes tropaniques).
La renoncule rampante (ranunculus repens)
Couramment nommée “bouton d’or”, la renoncule rampante est une adventice faisant partie de la famille des renonculacées.
Mesurant de 20 à 50 cm de haut, elle s’étend principalement en développant ses puissants stolons, mais également par germination.
Signalant un sol lourd, humide, souvent argileux et tassé, la renoncule rampante est toxique pour le bétail (qui n’y goûte guère en général). Une forte colonie de renoncule rampante doit nous inciter à drainer le terrain.
Le rumex (Rumex obtusifolius)

Le rumex témoigne d’un sol compacté, et par conséquent saturé en matières organiques et en eau, avec blocage des oligo-éléments et du phosphore.
Dans un potager où le rumex domine, tout apport supplémentaire de matières organiques risque de provoquer des dégâts irréversibles pour le sol (destruction du complexe argilo-humique).
Les feuilles (amères et astringentes) sont comestibles, mais déconseillées aux personnes souffrant de troubles rénaux.
La bourse à pasteur (notamment Capsella bursa-pastoris, Capsella rubella…)
La bourse à pasteur regroupe plusieurs espèces d’adventices herbacées de la famille des brassicacées.
Appréciées des oiseaux, ses graines sont très nombreuses.
S‘adaptant à tout type de sol et souvent parmi les premières plantes à coloniser un sol nu, la bourse à pasteur prévient en cela l’érosion.
Comestible (je n’y ai personnellement jamais goûté), la bourse à pasteur est plus utilisée pour ses vertus médicinales. (http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/HerbierMedicinal/Plante.aspx?doc=bourse_pasteur_hm)
Les adventices témoignant d’un état satisfaisant du sol
Le mouron des oiseaux (Stellaria media)
Le mouron des oiseaux est une plante annuelle commune de la familles des Caryophyllacées et très appréciée des oiseaux.
Cette adventice indique un sol équilibré et fertile, riche en matières organiques et en azote.
N’appréciant guère le calcaire, on peut limiter son développement en épandant un amendement calcaire avant les semis ou plantations.
Comestible, le mouron des oiseaux se consomme notamment en soupe ou en salade (feuilles et fleurs).
Le pourpier (Portulaca oleracea)
Le pourpier témoigne d’un sol riche en humus et chaud, mais également d’un certain tassement. Et, même s’il peut s’étendre de façon très importante, il est très facile de l’arracher, notamment quand le sol est humide.
Personnellement, je limite sa propagation au milieu des salades ou des carottes par exemple (le pourpier peut facilement étouffer les petites plantes), mais le laisse sans problème se développer au pied des plantes potagères à plus fort développement (tomates, aubergines, courges, melons, choux…).
Il assure ainsi une couverture du sol et lui permet de rester frais.
De surcroît, quelques feuilles (très riches en oligo-éléments) ajoutées à la salade apportent une touche originale… À découvrir !
L’amarante (Amaranthus)

L’amarante est également l’une des plantes adventices parmi les plus communes au potager.
Autrefois classée comme chénopodiacées, elle appartient aujourd’hui à la famille des Amaranthaceae.
Elle se développe principalement dans les sols riches en humus. Mais elle peut aussi indiquer un excès, ou au contraire, un manque, de potasse et/ou d’azote.
Notons qu’elle est résistante au Roundup ! Une alliée donc… Elle se reproduit par dispersion de ses graines.
Les feuilles et les graines sont comestibles et d’une grande qualité nutritionnelle et peuvent se cuisiner à l’infini (http://recettes.de/amarante). Certains jardiniers n’hésitent d’ailleurs plus à la cultiver au potager.
Le chénopode blanc (Chenopodium album)

Le chénopode appartient à la famille des chénopodiacées.
Il fait partie des adventices fréquemment rencontrées au jardin, et plus particulièrement au potager lorsque la terre vient d’être travaillée.
Il fleurit de juin à octobre et se ressème spontanément.
Tout comme l’amarante (elles font partie de la même famille et l’on retrouve souvent les deux plantes en voisinage), le chénopode indique un sol riche en humus.
Les feuilles de chénopode se consomment comme l’épinard.
Notons que l’on peut retrouver des plantes indiquant des qualités de sol différentes sur la même parcelle.
Par exemple, chez moi, la partie haute de ma parcelle principale a malheureusement vu l’apparition de datura alors que la partie basse abrite principalement du chénopode et de l’amarante.
Cela peut sans doute s’expliquer par un certain ruissellement des matières organiques vers le bas du terrain.
La période de travail du sol (trop humide par exemple) et les apports différents (en quantité, mais aussi en qualité) de matières organiques peuvent également expliquer de telles disparités sur un même terrain…
Que faire avec les adventices ?
Cette liste des adventices communes est bien sûr non exhaustive…
Parmi les plantes adventices, citons encore notamment l’oxalis, la potentille rampante…
Mon propos n’est pas de faire le tour de toutes les plantes sauvages au potager (Il existe quantité d’adventices au potager naturel; moins dans les jardins traités…)
J’ai donc choisi de présenter ici les adventices qui me semblaient les plus représentatives afin de mettre en lumière la corrélation entre l’apparition de certaines plantes et indications sur l’état d’un sol.
Avant de chercher à lutter (souvent vainement) contre les adventices, essayez plutôt de comprendre les raisons de leur présence.
Et intéressez-vous à ces causes plutôt qu’à leurs conséquences…
Bref, tirez profit des précieuses indications que vous offrent les plantes adventices pour mieux connaitre le sol de votre jardin :
- Les adventices vous indiquent un sol tassé, compacté ? Cultivez peut-être des engrais verts ;
- Les adventices vous indiquent un sol trop riche, sans doute saturé en matières organiques ? Calmez-vous sur les apports ;
- Les adventices vous indiquent au contraire un sol pauvre ? Apportez alors des matières organiques diverses et variées ;
- Les adventices vous indiquent un sol riche en humus ? Continuez… Vous êtes sur la bonne voie (mais surveillez l’apparition de plantes qui pourraient vous indiquer un excès…).
Pour aller plus loin avec les adventices
En complément de cet article, j’ai également publié un tableau des plantes bioindicatrices.
Et si le sujet des plantes bio-indicatrices vous passionne, je vous conseille vivement la lecture de l’ouvrage de référence, en 3 tomes de Gérard Ducerf :
- L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices, alimentaires et médicinales : Guide de diagnostic des sols Volume 1
- L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices, alimentaires et médicinales : Guide de diagnostic des sols Volume 2
- L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices, alimentaires et médicinales : Guide de diagnostic des sols Volume 3