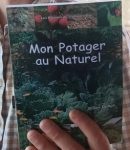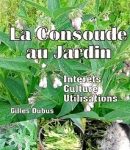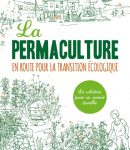Prendre l’exemple de la forêt en jardinage est une idée que l’on retrouve un peu partout (chez moi compris).
Et en effet, les mécanismes en jeu dans une forêt peuvent, à bien des égards, nous montrer la voie à suivre pour envisager avec enthousiasme et confiance un potager sain et productif.
Mais pour autant, cet exemple de la forêt est-il réellement opportun pour un jardin potager ?
Jusqu’où peut-on raisonnablement et utilement s’en inspirer ?
Essayons d’examiner les choses avec objectivité.
Pour ce faire, nous allons nous pencher sur 2 techniques (approches) de jardinage s’inspirant directement de la forêt :
- La couverture du sol
- Les jardins-forêts
Couverture du sol – Exemple de la forêt en jardinage en permaculture
Une couverture du sol protectrice et nourricière
Oui, une forêt n’a pas besoin de fertilisation extérieure ; les matériaux (feuilles mortes, branchages), mais aussi les déjections animales (Et oui… Il n’y a pas que les matériaux végétaux) suffisent à nourrir les arbres et autres plantes s’y développant.
On comprend donc aisément que cette couverture naturelle du sol est bénéfique, et même indispensable, au développement des végétaux constituant une forêt.
Et ce schéma peut aisément être reproduit dans un jardin, pour le plus grand bien de nos cultures.
Mais n’oublions pas que le processus en cours dans une forêt l’est depuis des centaines, voire des milliers, d’années… Ce qui n’est que rarement le cas d’un jardin potager.
Et surtout, si l’on veut prendre la forêt pour exemple dans nos jardins, encore faut-il être cohérent, en observant ce qui se passe réellement dans une zone forestière…
Or, c’est loin d’être le cas, comme nous allons le voir maintenant.
Une couverture du sol vraiment permanente ?
Il convient maintenant de se poser une simple question : dans une forêt, cette couverture est-elle réellement permanente comme l’affirme nombre de permaculteurs ?
En réalité, pas vraiment… Promenez-vous au printemps dans une forêt ; et vous verrez que, dans de nombreuses zones, les feuilles mortes ont pratiquement, voire totalement, disparues… Elles ont été digérées par le sol… qui, de fait, est souvent (presque) à nu…


Et pourtant, comme le soulignent à raison ces mêmes permaculteurs, la forêt prospère…
Ce qui discrédite finalement cette idée que le sol ne devrait jamais être à nu.
Une couverture du sol d’une épaisseur très importante ?
“Mettez au moins 30 ou 40 cm de paillage !”.
C’est là le mot d’ordre à la mode en permaculture…
Mais, là encore, il suffit de se promener dans la forêt, par exemple en fin d’automne, pour constater que l’épaisseur de matériaux (feuilles mortes et branchages) tombés au sol n’est pas aussi importante… Et, nous le disions plus haut, au printemps, cette épaisseur est encore moindre.
Si l’on veut prendre l’exemple de la forêt, l’épaisseur de couverture du sol doit donc être beaucoup plus raisonnable…
Et, quand on connaît les problèmes posés par une couverture du sol au printemps (empêchement du réchauffement du sol, destructions des jeunes plantules par les limaces, les petits rongeurs ou certains ravageurs du sol appréciant aussi une bonne couverture), n’est-on pas en droit de s’interroger ?
Je pense pour ma part que des compromis sont à faire…
Aussi, au printemps, une ou deux semaines avant de mettre en place des cultures, je fais donc le choix d’écarter le paillage (qui a joué son rôle protecteur et nourricier depuis le printemps précédent) afin de laisser le soleil réchauffer la terre (et si besoin de l’ameublir un peu avec ma Campagnole).
Le sol reste donc à nu, pendant quelques jours ou petites semaines… Et les cultures ne s’en portent finalement que mieux, sans pour autant nuire à la vie du sol (ou alors de façon très infime).
Une fois les cultures en place, je pratique ce que j’ai appelé le “paillage progressif” :
Je vous l’accorde, je prends également ici quelques libertés par rapport aux enseignements de la forêt…
L’épaisseur de la couverture est par exemple plus importante en été que celle d’une forêt. Mais les conditions ne sont pas non plus tout à fait les mêmes : dans une forêt, la ramure des arbres protège le sol des rayons du soleil… la couverture mise en place dans mon potager vient en quelque sorte compenser un peu cela.
“Mais Gilles… Si tu veux protéger tes cultures des rayonnements du soleil, implante un jardin-forêt !”
Ok… on y vient.
Exemple de la forêt et les jardins-forêts
Partant de cette notion d’exemple de la forêt en jardinage, la mode des jardins-forêts se développe considérablement.
Certes, ce modèle est tentant, et souvent très productif et convaincant… pendant quelques années, mais quand les arbres commencent à vraiment se développer, il en va souvent autrement.
Les légumes ne sont pas des plantes de forêt…

Dans la forêt, au pied des arbres, nous trouvons principalement de jeunes pousses d’arbres et des plantes arbustives.
Mais il n’y pousse en réalité que peu de plantes basses… des espèces d’ailleurs parfaitement adaptées à ce milieu particulier.
Et se développant de surcroît, pour la majorité d’entre-elles, dans des zones un peu dégagées…
Mais ce n’est pas le cas des légumes… Ce sont des plantes fragiles, améliorées et sélectionnées par l’homme au fil des siècles… Et qui requièrent un sol ameubli pour pouvoir se développer correctement.
Or, un sol de forêt est-il meuble ? Peut-on y creuser à la main facilement ? En général, pas vraiment.
Si vous semez directement sur ce sol non ameubli une graine de tomate ou de salade, se développera t-elle ? J’en doute fort.
Et pour peu qu’elle réussisse à démarrer, la jeune plantule ne sera-t-elle pas rapidement dévorée par un animal ? C’est plus que probable…
On voit donc que, pour ce qui concerne les cultures légumières, l’exemple de la forêt n’est pas vraiment adapté…
Le prendre en référence absolue pour un potager n’est donc tout simplement pas approprié !
Le développement racinaire des arbres finit par poser problème !
Lorsqu’un arbre est encore jeune, ses racines sont encore petites.
Mais lorsque ce même arbre grandit, ses racines se développent aussi en proportion.
On considère grossièrement que le système racinaire d’un arbre colonise à peu près la surface située sous sa ramure.
Or, ces racines vont puiser une grande partie des éléments nutritifs présents dans le sol…
Elles vont également tout simplement, dans bien des cas, empêcher le développement racinaire de nos cultures…
La proximité immédiate des arbres n’est donc pas non plus appropriée à des cultures légumières.
Alors, certains ne manqueront pas de m’objecter que l’on peut planter des arbres “fixateurs d’azote”, censés enrichir notre jardin…
Oui, certaines essences d’arbres ou arbustes (par exemple l’aulne glutineux, l’aulne rugueux, le robinier faux-acacias, l’argousier…) vont en effet puiser dans le sol, ou même capter de l’azote dans l’atmosphère… Mais c’est très minime… Et surtout, cet azote ne sera aucunement restitué aux cultures en cours… Ce n’est que lorsque les feuilles de l’arbre tomberont au sol, et se décomposeront, que cet azote sera disponible… c’est-à-dire en hiver (le temps qu’elles se décomposent)…Alors sanss doute en reste t-il un peu pour les cultures au printemps suivant. Mais cela compense-t-il les quantités absorbées par l’arbre dans le sol ? Permettez-moi d’en douter.
L’ombrage constitue également un problème…

Dans les premières années de développement d’un jardin-forêt, l’ombre créée par de jeunes arbres, étant peu conséquente, ne pose pas trop de problème.
Elle peut même être bénéfique pour les cultures potagères, en particulier en cas de canicule.
Mais plus les années passent, plus cette ombre devient importante… pour finalement recouvrir tout le jardin.
Or, certaines cultures (en particulier les légumes fruits) ont bien du mal à se développer et surtout à produire correctement à l’ombre…
C’est ainsi que, de plus en plus fréquemment, je reçois des questions du genre : “J’ai un beau jardin forêt… Je ne comprends pas… Depuis 2 ou 3 ans, mes plants de tomates ne donnent plus rien…”. Et, lorsqu’une photo est jointe au message, je comprends de suite pourquoi… les plants de tomates sont à l’aplomb d’un magnifique cerisier d’une quinzaine d’années… donc totalement à l’ombre et avec des racines en concurrence directe avec celles du cerisier… Lequel l’emporte d’après vous ?
Conclusion
La couverture du sol doit être réfléchie et est à adapter aux différentes situations…
Il y a une réflexion à avoir, des compromis à faire, en fonction du sol, du climat et d’autres paramètres propres à chaque environnement.
En faire un dogme est à mon avis (qui n’engage que moi) une pure bêtise.
Pour ce qui concerne les arbres, soyons clairs : ils ont toute leur place dans un jardin.
Ils apporteront notamment des matières organiques utiles et contribuent concrètement et largement à la préservation de la biodiversité… Sans parler de l’intérêt ornemental indéniable.
Mais la place d’un arbre à forte envergure (Pensez toujours à son développement futur… Un chêne n’est pas un noisetier…) est, à mon sens, un minimum à l’écart des cultures.
Les arbustes pourront plus facilement s’intercaler au sein même du potager… Mais en étant là aussi vigilant quant au développement futur des racines et de l’ombrage.
Bref, comme toujours, une analyse objective des choses est largement préférable à une obéissance aveugle à un dogme, quel qu’il soit.
Il y a des choses à puiser dans l’observation des processus en jeu dans la forêt… Mais n’en faisons pas n’importe quoi !
Vos commentaires, réflexions et partages d’expériences sur le sujet sont bienvenus… Même s’ils sont en désaccord avec ma vision des choses (nous sommes là pour avancer ensemble, pas pour rester figés sur des certitudes).
A vos claviers donc !