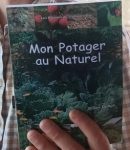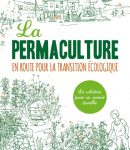La Nature est tout simplement la base de mon engagement professionnel. Et si j’ai un jour décidé de me diriger vers l’agriculture biologique, c’est bien, avant tout, par amour de la Nature.
 Ma question, à l’époque, était : comment puis-je m’épanouir, physiquement, mais aussi intérieurement, dans un environnement sain tout en contribuant, humblement, à mon niveau, à la préservation de notre environnement naturel ?
Ma question, à l’époque, était : comment puis-je m’épanouir, physiquement, mais aussi intérieurement, dans un environnement sain tout en contribuant, humblement, à mon niveau, à la préservation de notre environnement naturel ?
Mais alors, après toutes ces années, dans ma pratique du jardinage, en quoi cette place prépondérante de la Nature se concrétise-t-elle ? Et pour quels bénéfices ?
Préservation de l’environnement
Nous l’avons vu, la préservation de l’environnement constitue tout simplement un fondement de mon engagement. Aussi, dans mon approche du jardinage, je veille à toujours préserver des zones sauvages.
Le jardinier a très souvent tendance à vouloir dominer la Nature. Or, Dame Nature se débrouille très bien sans nous ! Pire, plus nous agissons, plus nous créons de déséquilibres dans cette symbiose sur laquelle tout repose.
Alors certes, jardiner implique d’agir (même si nous jardinons naturellement), avec certaines conséquences “néfastes”… Mais prenons au moins soin de laisser une place importante à la nature sauvage autour et au sein de nos parcelles cultivées.
Pour ma part, je laisse la végétation spontanée se développer tout autour de mes parcelles cultivées, mais également sur mes “allées”. Bien sûr, je fauche parfois certaines zones, mais jamais toutes en même temps… Ainsi, il y a toujours des zones sauvages dans mon jardin. De même des haies sauvages (ronciers par exemple) ont toute leur place dans un jardin naturel.
Nous participerons ainsi, à l’échelle de notre jardin (ce qui n’est déjà pas si mal) à préserver un tant soit peu notre environnement naturel. Et contribuerons par là même à une certaine diversification de la vie…
Diversification
La diversité (animale, végétale ou même minérale) constitue elle aussi un point essentiel d’une approche écologique du jardinage.
Ces différentes formes de vie, et chacun des éléments particuliers qui en font partie, forment un tout magnifiquement structuré.

Tel élément minéral (eau, roche, terre…) ou végétal va abriter une multitude d’organismes vivants, des plus invisibles aux plus “voyants”… Et chacun d’entre eux fait partie intégrante d’une chaîne de vie parfaitement équilibrée (du moins à l’origine…).
Détruisez un seul de ces éléments, et c’est tout un écosystème qui s’en retrouve perturbé… Avec par exemple la prolifération de tel ou tel insecte qui, de par l’absence de son prédateur naturel, deviendra alors ce que l’on appelle un nuisible…
Dans mon jardin, une mare, des tas de branchages ou encore des murets de pierres viennent offrir des abris diversifiés, aptes à accueillir une faune dès lors très variée. Et les populations animales se régulent, la plupart du temps, ainsi d’elles-mêmes, sans nulle intervention de ma part. De fait, depuis des années, les ravages dus à des insectes sont rares.
De même, mélanger différentes cultures légumières, ou encore y intégrer des fleurs ou des aromates participera à cette diversification fort bénéfique dans un jardin potager… Mais c’est là un autre sujet puisque l’on s’éloigne quelque peu de la Nature à proprement parler (la plupart des plantes cultivées ne sont plus vraiment “naturelles” puisque sélectionnées et améliorées par l’Homme).
Un sol vivant
Mais comment parler d’importance de la Nature dans notre jardin sans prendre en considération ce qui constitue le fondement même des cultures, à savoir le Sol.
Car c’est bien dans ce sol que les plantes cultivées vont puiser l’essentiel des éléments minéraux dont elles ont besoin pour se développer harmonieusement.
Notre objectif, en tant que jardinier sera donc de rendre ce sol le plus vivant possible, lui conférant ainsi une grande fertilité.

Pour ce faire, il suffit d’observer la Nature, et en l’occurrence, une forêt…
Vous constaterez alors, une fois encore, que la Nature fait merveilleusement bien les choses : les feuilles mortes, les branchages cassés par le vent ou de plus grosses branches succombant au poids de l’âge… viennent s’accumuler sur le sol, formant ainsi, au fil des saisons et grâce aux organismes vivant dans le sol, un riche humus, capable de nourrir les plantes les plus gourmandes qui soient… à savoir les arbres forestiers.
Comprenant cela, et reproduisant intelligemment ce que fait la Nature, il nous suffit alors d’apporter des matières organiques diversifiées (azotées et carbonées, comme pour un compost) directement sur le sol pour voir, années après années, la terre de notre jardin devenir de plus en plus fertile.
J’aborde cette question plus précisément sur l’article intitulé “Composter en place“.
Nos cultures se développent alors très bien, et de façon équilibrée. Les plantes sont, de ce fait, naturellement résistantes, limitant ainsi là encore les problèmes de “nuisibles” ou même de maladies.
Utilisation de matériaux “locaux”
Tout au moins à la campagne, les matériaux naturels ne manquent pas, en particulier si on laisse des zones sauvages comme je l’explique plus haut.
La Nature nous offre quantités de matériaux renouvelables pour nourrir notre terre (tontes, fauches, tailles de haies ou d’arbres, feuilles mortes…) ou encore pour “tuteurer” certaines cultures. Profitons de ces bienfaits. Cela ne coûte rien… et une armature en branches de noisetiers par exemple sera du plus bel effet !
Conclusion
La Nature a une place centrale dans mon approche du potager au naturel, pour le plus grand bénéfice de mes cultures : plantes en bonne santé, résistantes aux attaques animales et aux maladies, récoltes abondantes…
Et, personnellement, je ne vois tout simplement pas d’autres façons d’aborder les choses, tant pour ce qui concerne ma philosophie de vie que l’efficacité du jardinage au naturel (on parle aujourd’hui plus volontiers de “permaculture“).
Cet article s’inscrit dans le cadre d’un carnaval d’articles initié par Heikel, du blog Jardiner Futé.
Le livre numérique regroupant tous les articles est maintenant téléchargeable gratuitement en cliquant ici.
Mais vous-même… Quelle place accordez-vous à la Nature dans votre pratique du jardinage, et plus largement dans votre vie ? Vos témoignages sont bienvenus !