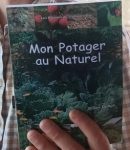Les buttes en permaculture sont souvent présentées comme une solution incontournable pour réussir son potager. Dans de nombreux livres et articles, elles apparaissent presque indissociables de la permaculture (voire qu’elles sont la définition même de cette philosophie), au point que beaucoup de jardiniers débutants pensent qu’elles sont indispensables.
Mais est-ce vraiment le cas ?
En réalité, la culture sur butte a été pensée pour répondre à des contextes bien particuliers, notamment les sols pauvres ou les climats secs. Dans la majorité des jardins, cette technique peut s’avérer inutile, voire contre-productive.
Dans cet article, nous allons démystifier la butte en permaculture : quand est-elle réellement utile, quelles sont ses limites, et quelles alternatives existent pour cultiver efficacement en respectant les principes du potager bio ?
Revenir aux fondamentaux de la permaculture
Avant de parler de buttes, il est important de revenir aux fondamentaux de la permaculture qui sont de cultiver son potager en s’approchant au plus près du fonctionnement des écosystèmes naturels.
Pour cela, je vous conseille de mettre en pratique les principes suivants :
- Ne pas bêcher pour éviter d’enfouir la matière organique et pour limiter l’érosion.
- Créer de l’humus en mettant des paillages et en pratiquant le compostage en surface.
- Ne jamais utiliser de produits de traitement autres que des préparations naturelles à base de plantes que l’on fabrique soi-même.
- Ne pas utiliser de semences hybrides.
- Se servir au maximum des ressources disponibles près de son potager.
- Ne plus considérer les ravageurs comme des nuisibles. Mais apprendre à cohabiter avec en favorisant la biodiversité dans le but de créer un équilibre.
Il est tout à fait possible de faire de la permaculture sans faire de buttes de cultures. D’ailleurs dans la nature, les plantes n’ont pas besoin d’être sur des buttes pour s’épanouir. L’humus présent en surface et les minéraux contenus dans les roches du sol leur suffisent amplement !
Buttes de compost vs. buttes vivantes : ne pas confondre
On parle souvent de « buttes » en permaculture, mais il existe en réalité plusieurs approches bien différentes. Or, les confusions sont fréquentes, et elles expliquent en partie les débats autour de leur utilité.
Les buttes de compost

Il s’agit ici de constituer des buttes de 20 à 40 cm de hauteur en apportant d’importantes quantités de compost (souvent mélangé à du bois ou à des végétaux enfouis), sur une hauteur de 20 à 40 cm.
Avantage : peuvent améliorer un sol très pauvre, sec ou caillouteux.
Inconvénients : demandent beaucoup de matières organiques, perturbent l’équilibre naturel du sol et nécessitent un gros travail physique. Dans la plupart des jardins français, elles sont donc peu utiles, voire contre-productives.
Les buttes vivantes ou buttes lasagnes

Les buttes lasagnes reposent sur un principe différent : superposer des couches de matières brunes (feuilles mortes, broyats, carton) et de matières vertes (herbes fraîches, déchets de cuisine, consoude, orties…). La butte se décompose progressivement en surface et nourrit la vie du sol.
Avantage : favorisent la biodiversité, s’adaptent à de nombreuses situations et s’inscrivent dans la logique du sol vivant.
Inconvénient : requièrent beaucoup de matières organiques, un gros travail de préparation initiale et un entretien régulier (paillage, apports organiques).
Pourquoi dans la plupart des cas, il n’est pas intéressant de pratiquer la culture sur buttes ?
Sur un terrain déjà fertile, ce qui est le cas dans la plupart des régions de France, la création de buttes aura pour conséquence de bouleverser l’équilibre d’un sol déjà bien établi.
Cela reviendrait à faire de la culture hors-sol. Ce qui est totalement inutile même si l’on dispose d’un sol de qualité moyenne. Car il sera facile de l’enrichir par des apports réguliers de matières organiques en surface.
Créer des buttes nécessite un apport très important en matériaux organiques que l’on ne peut pas toujours trouver sur place. Cela demande aussi de fournir un effort physique conséquent, ce qui oblige à ce limiter à de toutes petites surfaces.
Pour ma part, j’ai mis un an pour créer un potager de 300 m2, si j’avais utilisé la technique des buttes, j’aurais dû me limiter à quelques dizaines de mètres carrés de légumes.
De plus la technique que préconisent certains auteurs, qui consiste à enterrer profondément des végétaux non décomposés et du bois dans les buttes est même néfaste pour l’équilibre du sol.
Pour obtenir un sol vivant riche en humus la matière organique doit se décomposer en surface en présence d’oxygène. C’est pour cela qu’il est très intéressant de pratiquer le compostage des déchets végétaux en surface directement dans les planches de cultures et non en profondeur.
Sol fertile sans buttes : les alternatives efficaces

Vous n’êtes pas obligé de construire des buttes pour avoir un sol vivant et productif. Il existe plusieurs méthodes simples et naturelles pour enrichir votre potager tout en respectant les principes de la permaculture :
- Le paillage : étalez des feuilles mortes, de la paille, du foin, du BRF ou des résidus de récolte sur vos planches de culture. Le paillage protège le sol du dessèchement, limite l’érosion, régule l’humidité et nourrit la vie microbienne. Il réduit aussi le développement des mauvaises herbes et améliore la structure du sol sur le long terme.
- Le compostage de surface : déposez des matériaux organiques directement sur le sol. Cette méthode enrichit progressivement le sol en humus, stimule l’activité des vers de terre et fournit tous les nutriments nécessaires aux cultures, sans perturber la structure naturelle du sol.
- Les engrais verts : semer des plantes engrais verts, comme la moutarde, le trèfle ou la phacélie entre vos cultures principales protège le sol, fixe l’azote et augmente la biodiversité. Une fois fauchés et laissés sur place, ces engrais verts se décomposent et nourrissent naturellement la terre.
- Le BRF (Bois Raméal Fragmenté) : épandez du BRF sur vos planches pour stimuler la vie microbienne, améliorer la structure du sol et créer un apport durable de matière organique. Il se décompose lentement, enrichissant le sol et favorisant la fertilité du potager.
En combinant ces techniques, vous obtenez un potager bio productif et facile à entretenir, avec un sol vivant, riche en nutriments et parfaitement adapté aux plantations de saison, sans le travail intensif que nécessitent les buttes traditionnelles.
Astuces pratiques pour enrichir votre sol sans buttes
- Paillage régulier : renouvelez-le tous les 2-3 mois ou après de fortes pluies pour maintenir l’humidité et protéger le sol.
- Compostage de surface : étalez 2 à 5 cm de compost mûr autour des plantes sans le mélanger à la terre.
- Engrais verts : semez-les en automne ou au printemps selon la culture suivante, et fauchez-les avant floraison pour qu’ils se décomposent sur place.
- BRF : ajoutez-le par couches fines (2-3 cm) pour ne pas étouffer la microfaune, et laissez-le se décomposer progressivement.
- Rotation et diversité : alternez cultures et engrais verts pour éviter l’appauvrissement du sol et stimuler la biodiversité.
Dans quel cas la culture sur buttes est-elle réellement adaptée ?
La culture sur butte est adaptée aux régions aux sols très secs, caillouteux et pauvres en matière organique, où un simple mulch ne suffira pas. Cela est le cas surtout en climat méditerranéen et dans certaines régions plus septentrionales aux sols très argileux.
Dans une telle situation, il peut être judicieux de se limiter à de plus petites surfaces et de monter des buttes lasagnes ou de compost bien mûr (en veillant à ne pas enfouir de matière organique non décomposée). Une fois les buttes créées, il n’y aura plus qu’à faire des apports réguliers de pailles, et de déchets végétaux en surface comme sur un sol classique.
Comparaison de différentes techniques en permaculture
Pour mieux comprendre leur utilité et choisir la technique adaptée à votre jardin, voici un tableau synthétique des avantages et limites des différentes buttes.
| Option | Avantages | Inconvénients | Quand l’utiliser ? |
| Buttes de compost | – Recyclent une grande quantité de matière organique – Créent un sol riche et fertile à moyen terme – Structure aérée pour certaines cultures | – Mise en place exigeante en temps et matériaux – Peu adaptées aux sols déjà riches ou au climat sec – Risque de dessèchement rapide | Intéressant dans des contextes précis (excès de matières organiques, sols lourds à alléger, climat humide). |
| Buttes vivantes / lasagnes | – Très productives les premières années – Idéales pour petits potagers ou débutants | – Demandent beaucoup de matériaux au départ – Fertilité qui diminue avec le temps – Peu adaptées aux grandes surfaces | Utile pour un potager de taille réduite, en sol pauvre ou difficile à travailler. |
| Paillage | – Protège le sol contre la sécheresse – Nourrit la vie du sol en continu – Simple et rapide à mettre en place | – Nécessite un apport régulier – Peut attirer limaces et rongeurs si mal géré | Solution polyvalente, adaptée à presque tous les potagers. |
| Compostage de surface | – Valorise directement les déchets de cuisine et de jardin – Stimule l’activité biologique – Très faible coût | – Esthétique parfois discutable – Demande une répartition régulière pour être efficace | Idéal pour enrichir naturellement le sol sans gros travaux. |
| Engrais verts | – Améliorent la structure et la fertilité du sol – Limitent l’érosion et la pousse des adventices – Fixation d’azote selon les espèces | – Nécessitent un temps de culture sans récolte – Doivent être bien gérés pour éviter l’envahissement | Particulièrement adaptés pour reposer et régénérer une parcelle. |
En conclusion
En définitive, les buttes en permaculture ne sont pas une recette miracle universelle. Si elles peuvent rendre de grands services dans des sols pauvres, secs ou caillouteux, elles restent souvent inutiles — voire contre-productives — dans des jardins déjà fertiles.
La permaculture ne se résume pas à une technique, mais à une démarche globale : observer son sol, favoriser la biodiversité, enrichir la terre par des apports réguliers de matière organique et créer un écosystème équilibré.
Avant de construire des buttes, posez-vous la question essentielle : est-ce vraiment adapté à mon terrain et à mes besoins ? Dans bien des cas, un sol vivant, bien paillé et enrichi en surface sera plus simple à entretenir… et tout aussi productif.
FAQ – Buttes et permaculture
Quand les buttes de permaculture sont-elles vraiment utiles ?
Les buttes sont intéressantes dans les sols pauvres, secs, caillouteux ou très argileux, où un simple paillage ne suffit pas. Elles permettent d’apporter de la matière organique et d’améliorer la structure du sol dans ces conditions difficiles.
Faut-il forcément faire des buttes pour jardiner en permaculture ?
Non, la permaculture ne se limite pas aux buttes. On peut parfaitement pratiquer le paillage, le compostage de surface, la rotation des cultures et la biodiversité sans jamais construire de butte.
Comment enrichir son sol sans faire de buttes ?
Il suffit d’apporter régulièrement de la matière organique en surface : compost, tontes de gazon, feuilles mortes, BRF… Associés à un bon paillage, ces apports favorisent la création d’humus et nourrissent la vie du sol.
Quelle est la différence entre buttes de compost et buttes vivantes ?
Les buttes de compost reposent sur de gros apports de matières organiques parfois enfouies, alors que les buttes vivantes (ou lasagnes) fonctionnent par superposition de couches brunes et vertes qui se décomposent lentement en surface.
Peut-on obtenir un sol fertile sans recourir aux buttes ?
Oui, un sol bien couvert, paillé et enrichi progressivement en surface peut devenir très fertile. C’est souvent plus simple et moins coûteux que la construction de buttes.
Quelle surface prévoir si l’on souhaite quand même faire des buttes ?
Une butte classique mesure environ 1,20 m de large sur 4 à 6 m de long. L’important est de garder une largeur qui permette de cultiver sans marcher sur la butte, afin de préserver la vie du sol.
Crédit photos : https://depositphotos.com/fr/